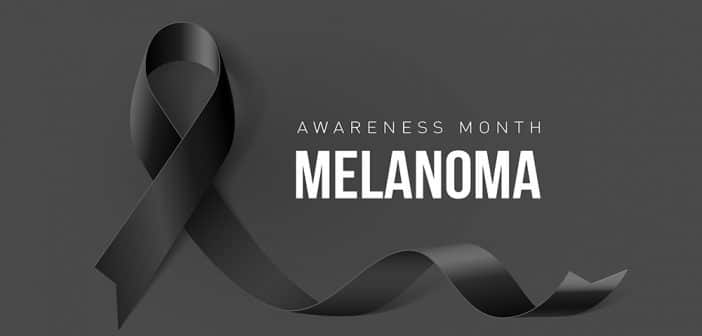Le premier laser fractionné fut commercialisé en 2005, le concept de fractionnement étant alors appliqué à un laser infrarouge non ablatif. Cette technique révolutionnaire n’a cessé, depuis lors, de se voir déclinée en association avec différents dispositifs “vecteurs” allant des micro-ondes aux ondes à radiofréquence, en passant par des lasers émettant dans les infrarouges – ablatifs ou non – et même, tout récemment, les lasers picosecondes !
Quel que soit leur mode de production de chaleur, l’ensemble de ces dispositifs repose sur un principe commun : infliger à la peau une multitude de micro-lésions thermiques de petite surface mais de profondeur importante, permettant d’induire des augmentations focalisées de la température dermique au-delà des seuils de remodelage et de destruction tissulaire respectivement évalués à
45 et 60 °C.
Cet apport de chaleur conduit à un remaniement tissulaire en profondeur, d’un diamètre suffisamment étroit pour ne pas induire de risque cicatriciel par respect des zones interlésionnelles indemnes. C’est la forme de ces microlésions qui est à l’origine des termes de puits thermique ou MTZ (microthermal zone).
Parmi les matériels, lasers ou non, qui vont délivrer leur énergie sur un mode fractionné, seuls les lasers fractionnés ablatifs vont joindre à cet effet thermique une perte de substance réelle, que l’on pourrait comparer à l’empreinte que laisserait un pic à glace d’une centaine de microns de diamètre planté verticalement dans la peau.
La lésion unitaire résultante de ce double phénomène va prendre le nom de cône d’ablation thermique. Il faut avoir à l’esprit que les lasers fractionnés ablatifs ont été conçus primitivement pour corriger les effets du vieillissement cutané et estomper certaines cicatrices.
Comme souvent dans le domaine des lasers, mais ici sans doute plus qu’ailleurs, ils ont vu leur horizon d’application s’étendre progressivement, trouvant dans certaines des caractéristiques de notre petit cône d’ablation de nouveaux champs thérapeutiques.
Si nous nous intéressons à ce stade au mécanisme de formation de ces cônes d’ablation (que ce soit par le biais d’un laser Erbium-YAG ou d’un laser CO2), la production sur un temps très court d’un faisceau focalisé unitaire d’une centaine de microns – pendant une durée de l’ordre, disons, d’une dizaine de milli-secondes – va aboutir à une séquence qui, si on la filmait à l’aide d’une hyper-caméra, se déroulerait[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire