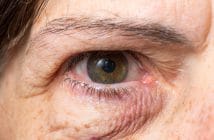Il aura fallu un certain nombre de catastrophes sanitaires pour que s’impose la nécessité de systèmes de vigilance. En 1961, la révélation de la tératogénicité du Thalidomide, somnifère “idéal” responsable de la naissance de 20 000 enfants gravement malformés (phocomélie), fut un véritable électrochoc et conduisit l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à créer un système de pharmacovigilance. Après les bébés “Thalidomide” vinrent les filles Distilbène, subissant les redoutables effets transgénérationnels de ce médicament. Et d’autres encore : en 1972, l’erreur de fabrication du talc Morhange, qui causa le décès de 36 nourrissons ; la tératogénicité des rétinoïdes, identifiée précocement mais difficile à écarter complètement car les mesures de prévention des grossesses ne sont pas toujours respectées ; le sang contaminé par le VIH, qui fit en France de nombreux morts, notamment chez les hémophiles polytransfusés. Plus près de nous, ce sont les risques cardiovasculaires engendrés par l’anti-inflammatoire rofécoxib et le Médiator détourné de son AMM initiale, ou celui lié à la fabrication frauduleuse des prothèses mammaires PIP.
En France, ces risques très divers ont conduit les autorités de santé à créer 8 vigilances sanitaires dont l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) assure la mise en œuvre :
- la pharmacovigilance ;
- l’addictovigilance (ou pharmacodépendance) ;
- l’hémovigilance ;
- la matériovigilance ;
- la réactovigilance (pour les dispositifs de diagnostic de laboratoire) ;
- la biovigilance (en particulier pour les greffes d’organe) ;
- la cosmétovigilance ;
- la vigilance des produits de tatouage.
Toutes ces vigilances sanitaires, à l’exemple de la pharmacovigilance, la plus ancienne et la plus structurée, doivent être ouvertes en permanence à l’inattendu, à des effets indésirables à long, voire à très long terme. Ces vigilances françaises sont, bien entendu, connectées à des structures de vigilance européennes et internationales.
Le recueil des effets indésirables est essentiellement basé sur la notification spontanée fournie par les professionnels de santé, mais aussi par les industriels et les patients – ou leurs associations agréées – avec, pour la pharmacovigilance, l’appui du réseau des 31 centres régionaux chapeautés par l’ANSM.
Un effet indésirable est une réaction nocive et non voulue à un médicament ou à un produit, dans les conditions normales d’utilisation, c’est-à-dire[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire