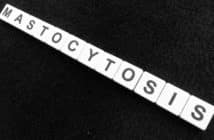- Les perturbateurs endocriniens environnementaux, un sujet d’actualité
- Définitions des PEE et modalités d’action
- 1. Définition des PEE : 1re définition scientifique dès 1991
- 2. Principes de toxicité spécifiques aux PEE : définitions toujours en cours…
- 3. Les PEE sont ubiquitaires
- Effets connus sur la santé
- 1. Activité estrogénique et PEE
- 2. Tissu adipeux et PEE : une interaction privilégiée
- Législation, décisions politiques
- Questions pour le dermatologue
Les perturbateurs endocriniens environnementaux, un sujet d’actualité
Les publications scientifiques sont de plus en plus nombreuses et précises, les communications médiatiques et les applications pour smartphone se multiplient. L’inquiétude chez nos patients commence à s’exprimer en consultation, en particulier lorsqu’une maladie chronique apparaît chez l’un d’eux. Cependant, le monde médical est insuffisamment formé et informé, c’est en tout cas ce qui ressort des conclusions de l’évaluation de la première stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE).
Cette communication reprend les données générales connues sur les perturbateurs endocriniens environnementaux (PEE) et le point de vue d’un pédiatre endocrinologue sur l’impact des perturbateurs endocriniens.
Définitions des PEE et modalités d’action
1. Définition des PEE : 1re définition scientifique dès 1991
Dès les années 1980, des études sur l’animal ont été menées pour étudier la toxicité endocrinienne de certaines substances chimiques comme les phtalates [1, 2]. En 1991, la réunion scientifique de Wingspread (Wisconsin, États-Unis) a défini l’existence de nombreux composés libérés dans l’environnement par les activités humaines, capables de dérégler le système endocrinien des animaux et de l’homme [3].
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire