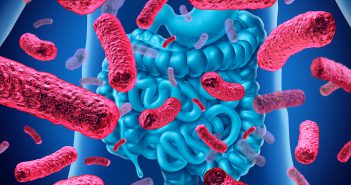
Stratégies spécifiques ou communes pour influencer le microbiote cutané
De nombreux micro-organismes colonisent la surface et l’intérieur de notre peau : il s’agit du microbiote cutané qui constitue une barrière protectrice. Pour tous ces micro-organismes, notre peau est un milieu de culture qui va contre-sélectionner ceux qui sont le plus adaptés à chaque zone anatomique selon le pH, la température, le taux d’humidité et la composition de chaque zone.
Les bactéries cutanées, par exemple, vont pouvoir s’organiser et se réguler entre elles via l’excrétion de molécules que nous pouvons reproduire. Elles peuvent aussi s’organiser au sein de biofilms que l’on peut déstabiliser.
Enfin, pour croître, les bactéries ont besoin de quatre composés essentiels : l’eau, une source de carbone, d’azote et des oligoéléments. Dans un avenir proche, il sera possible d’agir sur ces quatre éléments pour favoriser certaines bactéries aux dépens d’autres. Par ailleurs, l’apport de biomasses réalisées à partir de bactéries non pathogènes, stratégie qui a déjà fait ses preuves, permettra de rétablir une homéostasie de cette microflore.
Ces pistes se rapprochent des stratégies développées par l’industrie alimentaire, adaptées à une approche dermato-cosmétique.


