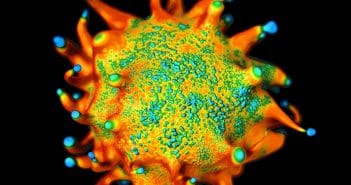L’immunité innée est une première ligne de défense ancienne, non-spécifique, faite de diverses barrières et d’éléments peu spécifiques, mais très rapidement mobilisable qui permet la mise en place d’une défense tout à fait efficace avant que l’immunité adaptative, plus performante et plus spécifique, puisse se mettre en place.
Son importance est actuellement en pleine redécouverte, et ses mécanismes commencent à être nettement mieux identifiés, en particulier les récepteurs aux signaux de “danger” (TLR et NLR), la machinerie intra-cellulaire (signalosome) et les divers éléments de la réaction effectrice incluant les peptides antimicrobiens.
Comme toutes les zones frontières avec le milieu extérieur, la peau a mis en place une immunité innée très efficace qui fait intervenir notamment les kératinocytes, et qui est en équilibre délicat avec le microbiome cutané commensal en particulier le bactériome. Des anomalies de cette immunité innée sont de plus en plus souvent mises en évidences dans des affections cutanées inflammatoires, en lien notamment avec des anomalies qualitatives et quantitatives du microbiome cutané. La manipulation de l’immunité innée cutanée, tant à la hausse qu’à la baisse, représente une voie de recherche importante et riche d’espoirs.