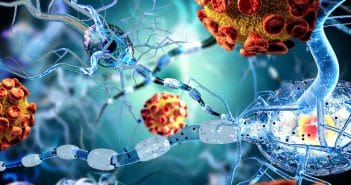La maladie de Kawasaki (MK) est une maladie aiguë et rare, mais qui peut léser les vaisseaux coronaires de façon définitive, représentant alors la première cause de cardiopathie acquise à l’âge pédiatrique dans les pays industrialisés. Elle touche avant tout les enfants de moins de 5 ans, beaucoup plus rarement de jeunes adultes avant l’âge de 40 ans.
L’introduction du traitement par immunoglobulines intraveineuses (IgIV) en 1984, associé à l’aspirine, a permis une réduction significative de la fréquence des lésions coronaires à 3-5 % (20-30 % sans traitement), permettant en parallèle d’améliorer notablement le pronostic global de la MK.
Mais, 10-20 % des patients traités par une cure de 2 g/kg IVIg demeurent fébriles ou redeviennent fébriles dans les 48 heures, et sont à haut risque de développer des lésions coronaires. Ce qui nécessite, d’une part, de trouver un traitement alternatif efficace et, d’autre part, d’identifier des marqueurs cliniques et biologiques de résistance aux IgIV qui pourraient permettre soit une intensification d’emblée du traitement par IgIV en les associant par exemple aux corticoïdes, soit le choix d’un autre traitement qui reste à définir.