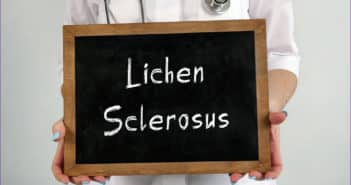Questions flash – Pathologies des muqueuses
Les chéilites sont des inflammations des lèvres mais, par extension, ce terme désigne souvent une affection des lèvres, quelle que soit la forme clinique. Cet article se concentrera sur une classification clinique des chéilites, en mettant en avant les principaux diagnostics différentiels des macrochéilies, et macrochéilites, chéilites desquamatives et croûteuses, chéilites érosives et ulcérées, chéilites pigmentées, chéilites actiniques et kératosiques.